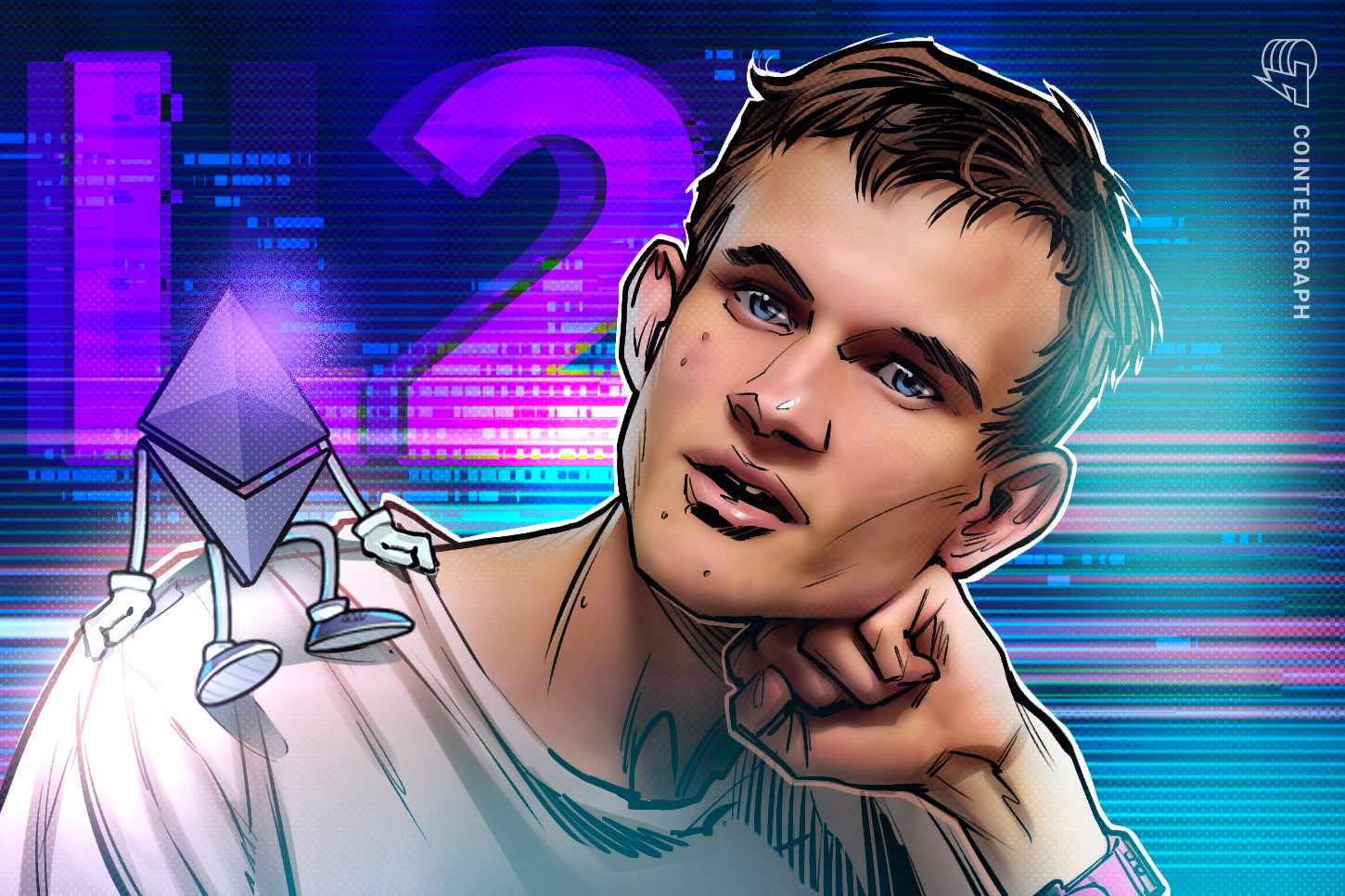Le cofondateur d’Ethereum a salué la stratégie de décentralisation adoptée par Base, la solution de couche 2 développée par Coinbase, alors que des critiques émergent sur le rôle de son séquenceur et sur la question de savoir s’il doit être assimilé à un exchange.
« Base fait les choses de la bonne manière : un L2 construit au-dessus d’Ethereum, qui utilise certaines fonctions centralisées pour offrir une meilleure expérience utilisateur, tout en restant relié à la couche décentralisée d’Ethereum pour la sécurité », a déclaré Vitalik Buterin mardi.
Il a ajouté que la solution L2 de Coinbase n’a pas la garde des fonds des utilisateurs : « ils ne peuvent ni voler les fonds ni vous empêcher de les retirer ».
Les véritables solutions L2 sont non-custodiales, a-t-il poursuivi. « Elles sont des extensions d’Ethereum, pas de simples serveurs améliorés qui se contentent de soumettre des hashes. »
Les propos de Buterin interviennent dans un contexte de scepticisme croissant autour de la définition des L2 et de leur degré de centralisation. Les réseaux de seconde couche ont été mis en lumière après des déclarations de la commissaire de la SEC, Hester Peirce, dans un podcast le 7 septembre.
Les L2 sont-ils assimilables à des exchanges ?
De nombreux L2 utilisent un séquençage centralisé des transactions afin d’améliorer les performances et de limiter le front running par les bots. Peirce a évoqué les implications réglementaires potentielles si ces « moteurs d’appariement » fonctionnaient comme des exchanges centralisés.
« Si vous avez un moteur d’appariement contrôlé par une seule entité qui gère tous les aspects du processus, cela ressemble beaucoup plus à un exchange, et nous devrons réfléchir à ce que cela implique »
Toutefois, elle a aussi précisé que si les actifs traités ne sont pas des titres financiers, « alors nous n’avons pas grand-chose à dire ».
Les L2, des fournisseurs d’infrastructure comme AWS
Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a rétorqué qu’assimiler les séquenceurs des L2 comme Base à des exchanges est une mauvaise compréhension de leur rôle et de leur fonctionnement.
Selon lui, la SEC définit un « exchange » comme un marché permettant de mettre en relation acheteurs et vendeurs de titres. Or, les L2 sont « des blockchains polyvalentes qui fonctionnent comme de l’infrastructure ».
Ces réseaux traitent des instructions sous forme de code, déclenchent des smart contracts et regroupent toutes sortes de transactions, qu’il s’agisse de paiements, d’appels ou de messages.
Paul Grewal a comparé les L2 comme Base à Amazon Web Services (AWS) : tous deux exécutent du code fourni par des développeurs, y compris des applications d’exchange, mais cela ne fait pas de l’infrastructure elle-même un exchange.
« Si un exchange fonctionne sur AWS, est-ce qu’AWS devient un exchange ? Évidemment non. »
Les séquenceurs ne sont pas des moteurs d’appariement
Jesse Pollak, cofondateur de Base, a apporté des précisions supplémentaires sur le rôle des séquenceurs.
Les utilisateurs peuvent effectuer leurs transactions via le séquenceur de Base ou directement sur Ethereum, ce qui garantit la décentralisation et la résistance à la censure, a-t-il souligné.
« C’est comme un régulateur de trafic qui assure une circulation fluide dans une voie prioritaire, permettant aux véhicules d’arriver plus rapidement à destination. »
Il a aussi dissipé la confusion avec les moteurs d’appariement, en précisant que les séquenceurs ne jouent pas ce rôle, contrairement aux systèmes utilisés dans les exchanges traditionnels.
« Les moteurs d’appariement associent des ordres d’achat et de vente à des prix spécifiques pour exécuter des transactions. Les séquenceurs ne font pas cela : ils déterminent simplement l’ordre dans lequel les transactions sont traitées. »
Si les L2 étaient classés comme des exchanges, ils devraient s’enregistrer auprès de la SEC en tant que plateformes de titres financiers, se conformer à de lourdes obligations réglementaires et pourraient voir leurs opérations limitées — d’où la résistance de l’industrie.